1.
Dialectes des fonds des mers
Source : sciencepost.fr
Étude complète : royalsocietypublishing.org
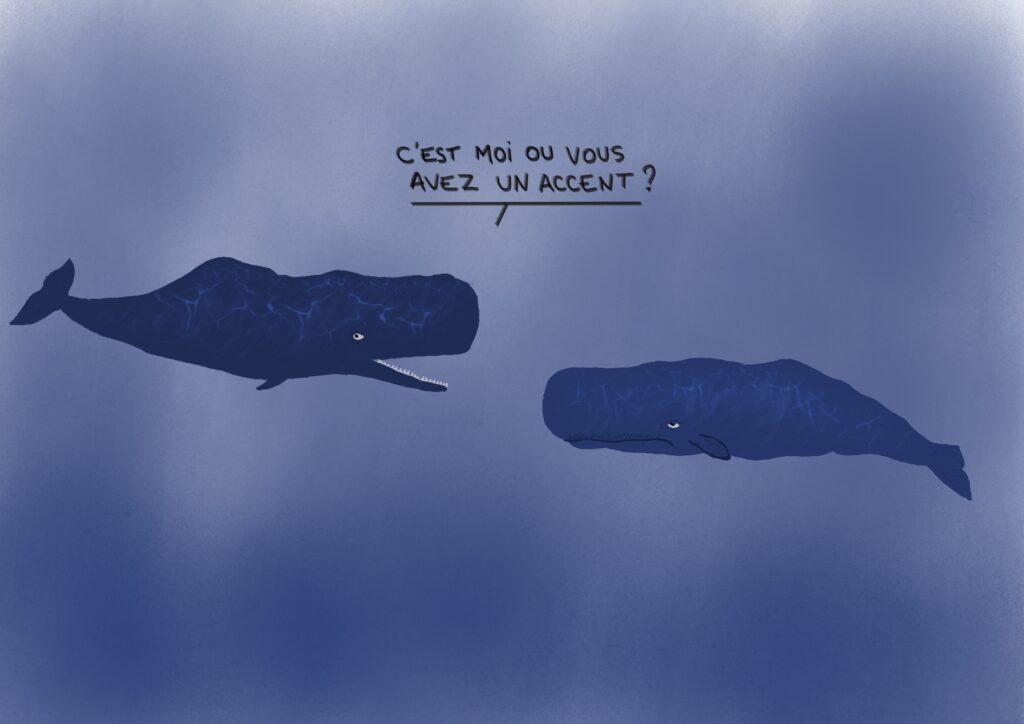
Des nouvelles pas si fraîches, puisque l’étude dont je veux vous parler date du mois de janvier 2024, mais pas moins intéressantes pour autant.
Je vous emmène dans les profondeurs de l’océan Pacifique, à la rencontre des cachalots, une espèce de cétacé qui a fait l’objet d’une longue étude menée par une équipe de chercheurs de l’Université de Dalhousie, au Canada.
Minute culture : ces géants des océans (les cachalots, pas les chercheurs) sont des carnassiers qui peuvent mesurer pas moins de vingt mètres de long, ce qui en fait les plus grands prédateurs marins de la planète. Nulle inquiétude d’en croiser lors de vos barbotages en bord de mer, le cachalot se nourrit principalement de calamars géants, qu’il n’hésite pas à aller chasser à plus de 2000 m de profondeur. Outre ses records de plongées en apnée, le cachalot détient également le record du plus gros cerveau répertorié (rien que ça !). Pour communiquer, les cachalots produisent notamment des « clics », isolés ou en rafale, souvent organisés en séquences, que l’on nomme « codas ».
Revenons donc à nos chercheurs canadiens. Pour en apprendre davantage sur la communication des cachalots, ils ont suivi, pendant de nombreuses années, les populations de l’océan Pacifique avec des microphones marins (des hydrophones, pour les puristes) pour enregistrer, et tenter de décrypter les codas, ces fameuses séquences de clics. Les résultats, tant attendus, de ces analyses ont finalement révélé l’existence de structures sociales très élaborées.
Les cachalots vivent au sein d’unités familiales matrilinéaires (c’est-à-dire un mode d’organisation social qui repose sur l’ascendance maternelle), composées d’environ une dizaine de femelles et de leur progéniture (les mâles jouent un rôle assez réduit, qui se cantonne peu ou prou à la reproduction). Les membres de ces unités familiales sont très proches et tissent des liens forts qui perdureront tout au long de leur vie. Interactions complexes, éducation des jeunes, défense contre les orques, les cachalots font preuve d’une forme de coopération sociale remarquable. Parfois, les unités familiales se regroupent pour former des sortes de maxi-clan, qui comptent des milliers d’individus (!). À titre d’échelle, les chercheurs indiquent la présence – tout clan confondu – d’à peu près 300 000 individus dans les eaux du Pacifique. Les cachalots, un brin sectaires, ne communiquent qu’avec les membres de leur propre clan. Si bien que chaque clan possède une palette de comportements non-vocaux distinctifs ainsi que son propre dialecte coda. Si tous les cachalots du Pacifique parlent globalement la même langue, il existe des distinctions non-négligeables en fonction des clans. Cette diversité linguistique au sein d’une même espèce témoigne d’une intelligence sociale mais aussi de l’existence d’une culture (orale, donc, jusqu’à preuve du contraire) spécifique à chaque clan, façonnée par des millions d’années d’évolution.
2.
Votre chien en sait peut-être trop
Source : sciencepost.fr
Étude complète : cell.com
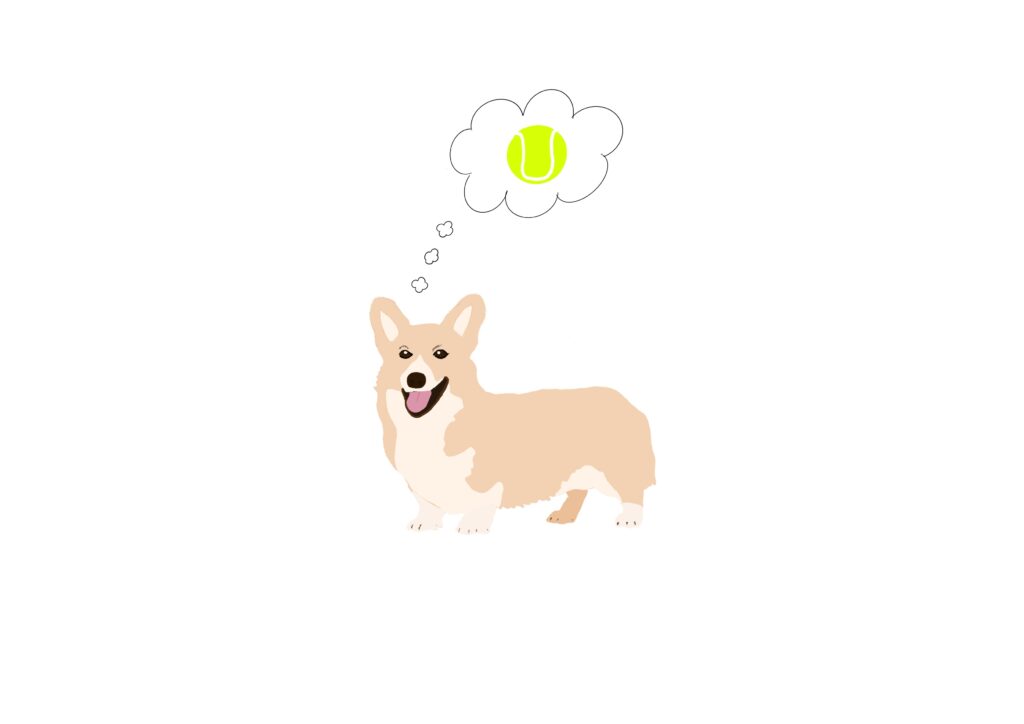
Sous-estimons-nous les chiens, nos compagnons fidèles depuis des millénaires ?
Il semblerait bien qu’on leur fasse cet affront, d’après une étude réalisée par des scientifiques hongrois, parue dans la revue Current Biology.
Lorsque vous lisez ou que vous entendez le mot « chien », vous arrivez a priori (enfin, je vous le souhaite) à faire le lien entre le mot et l’objet (l’animal en l’occurrence) dans le monde réel. Vous êtes en mesure de vous faire une représentation mentale de l’objet en question, que vous piochez dans votre mémoire lorsque ce dernier n’est pas présent.
C’est bon, tout le monde suit ?
Bon. C’est ce que l’on nomme la compréhension référentielle : la formation de représentations mentales d’objets désignés par des mots. L’humanité s’en félicite. C’est grâce à cette compréhension référentielle que nous pouvons nous comprendre lorsque nous parlons d’objets qui ne sont pas présents.
Chez les chiens, les recherches sur les compétences linguistiques s’étaient jusqu’à présent concentrées sur la discrimination auditive et la capacité à associer des mots avec des actions simples. Mais nos chercheurs hongrois ont voulu aller plus loin. Ils ont utilisé l’électroencéphalographie (mot-compte-triple) pour mesurer l’activité cérébrale de chiens, lorsqu’ils entendaient des mots de leur vocabulaire appris mis en rapport avec un objet présent. Par exemple, le propriétaire du chien disait « Toby, la balle » en montrant un frisbee. Cette erreur feinte provoquait, à coup sûr, un mini-bug chez nos amis canidés. L’activité cérébrale mesurée démontrait un effet similaire à l’effet N400 chez nous, humains, c’est-à-dire une réaction du cerveau lorsqu’un mot ne correspond pas à l’objet attendu.
Coup de théâtre au pays des sciences, l’humain ne serait pas le seul à montrer une compréhension référentielle, et les chiens auraient donc les capacités cognitives nécessaires pour former des représentations mentales des objets évoqués (et de s’en souvenir). Ces capacités semblent liées à l’expérience du chien avec l’objet, plutôt qu’à la taille du vocabulaire appris, ce qui indiquerait que le traitement sémantique est inhérent à l’espèce, et ne résulte pas d’un entraînement approfondi. Petite nuance toutefois, les scientifiques indiquent que, contrairement aux humains, les chiens semblent faire correspondre des noms d’objets à des objets individuels, plutôt qu’à des catégories d’objets (on parle donc de cette balle en question).
Au passage, nous parlons ici de mots du langage humain, il s’agit donc d’une LV2 pour les chiens, qui maîtrisent déjà tout un répertoire comportemental pour communiquer avec les individus de leur espèce.
3.
Araignées volantes : l’art du Ballooning

En 1832, le bien-connu Charles Darwin voyageait à bord de son navire, le H.M.S. Beagle à une centaine de kilomètres des côtes sud-américaines. Quelle ne fut pas sa surprise de constater l’atterrissage, en toute tranquillité, d’araignées sur son navire.
Mais diantre, d’où venaient-elles ?
Excellente question, à laquelle la science est capable de répondre aujourd’hui.
Quand on pense « animaux volants », on ne pense a priori pas aux araignées, que l’évolution, comme chacun le sait, n’a pas pourvu d’ailes. Mais n’allez pas croire que ce détail aurait arrêté nos amies arachnides.
En réalité, les araignées sont des pilotes aguerries, qui se déplacent en transport aérien.
Attendez… quoi ?
Les jeunes araignées, les araignées adultes de petit gabarit, certains acariens et certaines larves utilisent des fils de soie, et une technique bien rodée, pour se déplacer dans les airs au cours de voyages à distance variable : de quelques centimètres à plusieurs centaines de kilomètres. C’est un processus que l’on appelle le ballooning.
(Nota bene : pas de panique, nous parlons bien ici d’araignées de petite taille, vous ne risquez a priori pas de vous prendre une mygale dans les cheveux lors de votre prochaine sortie. Les organismes qui s’adonnent aux ballooning représentent, d’ailleurs, une part importante du plancton aérien – oui oui, ça existe !).
Le ballooning, c’est un savoir-faire ancestral, qui remonterait au Crétacé. C’est une technique de transport passif, mais pas que. Les vols sont soigneusement préparés. Il existe différentes techniques, certaines plus élaborées que d’autres : le ballooning suspendu par exemple, consiste à se laisser pendre au bout d’un fil de soie jusqu’à ce qu’un courant d’air casse et emporte le fil. Mais aussi des techniques fascinantes : certaines espèces sont capables de décoller en l’absence de vent, en utilisant les champs électriques naturellement présents dans l’atmosphère pour créer une portance. Cette courte vidéo de National Géographic, que je vous recommande chaudement, détaille ce phénomène. Une fois dans les airs, les araignées utilisent leurs pattes pour s’équilibrer ou contrôler leur vitesse.
Mais pourquoi se déplacer en volant ? Alors déjà, parce que si on peut le faire, c’est cool. Mais aussi pour permettre aux juvéniles de se disperser, pour échapper à des dangers, pour franchir des obstacles, pour agrandir son territoire de chasse ou, encore, pour coloniser de nouveaux milieux.
Attention, toutefois, le ballooning n’est pas sans risque ! Il existe un réel danger de se faire boulotter en cours de route (par des oiseaux, des chauves-souris, des poissons…) ou d’atterrir dans un environnement hostile (rivière, mer etc.).
Respect, donc, pour ces pilotes de la première heure.
Zoom sur…🔬

Kate Newman
Photographe animalier 🌿🐘🦒🌖
Suivre Kate Newman sur Instagram, c’est un peu comme boucler votre sac, enfiler vos meilleures chaussures de randonnée et l’accompagner en Australie, au Kenya ou en Afrique du Sud pour des têtes-à-têtes avec des macaques crabiers, des renard-volants, des aigles ravisseurs, des baleines à bosses, des oisillons céréopses cendrés, des éléphanteaux, des hyènes, des insectes multicolores et j’en passe. Bref, c’est une évasion depuis votre canapé (ou vos toilettes, c’est vous qui voyez) à la découverte de mille et une merveilles qui peuplent notre planète, grâce à son œil affuté 👁
